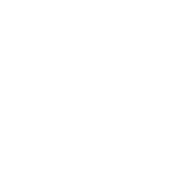La société coloniale : les inégalités institutionnalisées
Au moment où commence la guerre d'indépendance, l'inégalité est institutionnalisée au sein de la population d'Algérie. Une série d'ordonnances et de lois promulguées entre 1944 et 1947 met certes fin au code de l'indigénat, qui avait privé de facto la plupart des « musulmans d'Algérie» de tout pouvoir politique. Ces réformes n'établissent pas pour autant une égalité entre « Français musulmans » et « Français non musulmans » dans les départements algériens. Les droits civils diffèrent. L'accès au pouvoir politique également. Toutes les femmes algériennes restent privées du droit de vote. L'instauration d'un « double collège » (« collège musulman » et « collège de droit commun ») pour les élections locales et nationales revient à établir une égalité des pouvoirs entre les deux catégories de population, niant ainsi la prépondérance démographique des Français musulmans, ne leur accordant qu'une citoyenneté minorée. A cette inégalité, s'ajoute le trucage régulier des scrutins. Il faut attendre les ordonnances de novembre 1958, prises après le retour au pouvoir du général de Gaulle, pour que les Algériens, hommes et femmes, accèdent aux mêmes droits politiques que les autres citoyens français. Cette égalité, trop tardive, n'aura existé que les quatre dernières années de la colonisation.
Récit en écoute : Albelhamid et Hadria Gharib