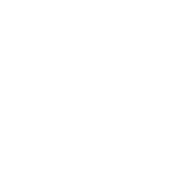La justice prise dans une logique de guerre
La participation de la justice à la répression des nationalistes et de leurs partisans découle directement du refus de reconnaître l'état de guerre sur le sol algérien. »
(S. Thénault)
Durant toute la guerre d'indépendance algérienne, les militants nationalistes algériens se sont vus refuser un statut de combattant. Nombre d'entre eux ont donc été déférés devant des tribunaux. Cette répression judiciaire amorcée en Algérie s'est étendue par la suite à la métropole.
Des deux côtés de la Méditerranée, les activités clandestines les moins graves comme les collectes de fonds ou la propagande, relèvent d'abord des tribunaux correctionnels devant lesquels les prévenus comparaissent pour « atteinte à la sûreté de l'Etat » ou « atteinte à la sûreté du territoire ».
En Algérie, en vertu de l'état d'urgence qui s'applique au territoire algérien en avril 1955, puis des « pouvoirs spéciaux » votés par l'Assemblée nationale en mars 1956, les actes des nationalistes qui peuvent être qualifiés de crimes ne sont plus jugés par des cours d'assises mais par des tribunaux militaires dont on attend une sévérité accrue. Dans le même temps, les suspects qui ne sont pas déférés font l'objet de mesures administratives : ils peuvent être internés dans des camps pour des durées indéterminées.
En métropole, l'internement administratif des suspects algériens dans des camps comme Thol (Ain) ou le Larzac (Aveyron) et le jugement d'accusés par des tribunaux militaires ne s'appliquent qu'à partir d'octobre 1958. Le gouvernement espère ainsi réprimer le FLN qui a ouvert un « second front » en France en août, en commettant des attentats contre les forces de police et contre certaines infrastructures comme le dépôt d'essence de Mourepiane, à côté de Marseille. Le tribunal militaire de Lyon ou Tribunal permanent des forces armées siégeait à Montluc.
grand ensemble
Récits en écoute : Yves Berger - Bernard Gouy - Georges Cochet - Pierre Cohendy
Justice
Bibliographie :
Sylvie THÉNAULT, Une drôle de justice, Les magistrats dans la guerre d'Algérie, Paris, La Découverte, 2001.
Sylvie THÉNAULT, La justice en guerre d’Algérie, in Mohamed HARBI et Benjamin STORA(dir.), La guerre d’Algérie, Paris, Hachette, 2004